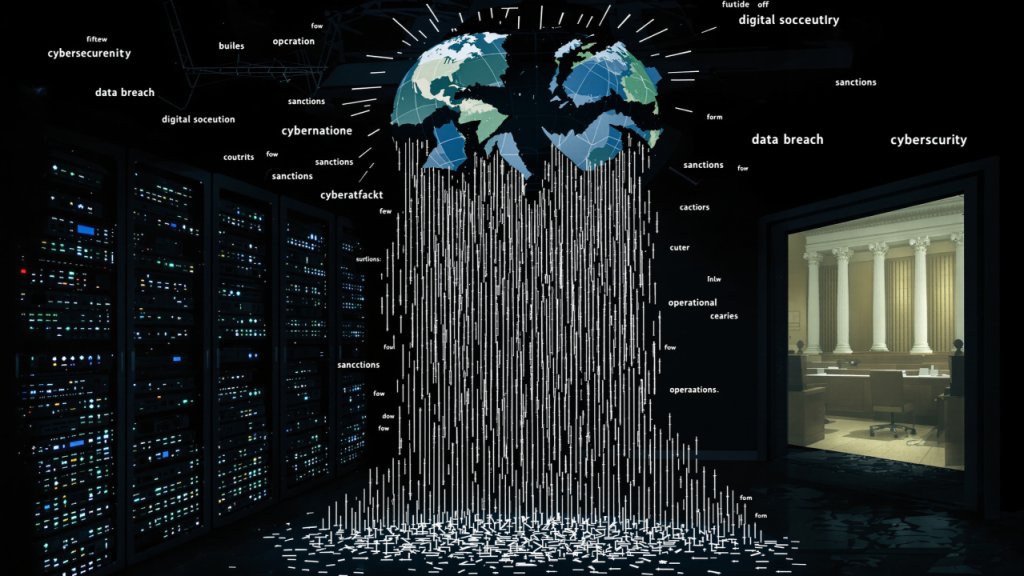
implications cybersécurité et entraves numériques
Je vous propose un article sur les impacts du changement de gouvernance aux États-Unis à travers un pas de côté, en adoptant un point de vue rarement exploré : celui de la cybersécurité.
Alors que l’attention médiatique s’est concentrée sur les aspects géopolitiques et juridiques des sanctions imposées en février 2025 par l’administration Trump à l’encontre du procureur de la Cour pénale internationale (CPI), cet article que je vous propose analyse en profondeur un versant stratégique bien plus discret mais tout aussi déterminant : l’impact de ces mesures sur les infrastructures numériques, les fournisseurs technologiques et la capacité opérationnelle d’une juridiction internationale dans un environnement de plus en plus numérisé.
En traitant les sanctions comme un levier d’influence géopolitique appliqué aux communications, aux services cloud, aux moyens de paiement et aux échanges internationaux d’information, nous abordons ici un cas concret de pression technopolitique. Ce récit révèle les tensions croissantes entre souveraineté numérique, indépendance judiciaire, sécurité de l’information et risques systémiques liés à la concentration des services numériques mondiaux. Un précédent majeur que les professionnels de la cybersécurité doivent aujourd’hui observer de près.
Une offensive sans précédent contre la CPI
En février 2025, l’administration Trump a pris une mesure sans précédent en sanctionnant le procureur en chef de la Cour pénale internationale (CPI), Karim Khan. Par un ordre exécutif signé le 6 février, le président Donald Trump a autorisé des sanctions économiques et juridiques visant la CPI et ses employés, en réaction directe aux enquêtes de la Cour touchant des citoyens américains ou leurs alliés. Cette décision faisait suite à l’émission de mandats d’arrêt par la CPI en novembre 2024 contre des responsables israéliens, dont le Premier ministre Benjamin Netanyahou, accusés de crimes de guerre à Gaza – ce qu’Israël dément vigoureusement. L’exécutif américain a qualifié les actions de la CPI d’« illégitimes et infondées », estimant qu’elles menacent la souveraineté et la sécurité nationale des États-Unis et celle de leurs alliés. Ainsi, la première personne désignée par ces sanctions n’est autre que Karim Khan, le procureur britannique de la CPI, désormais placé sur la même liste noire américaine que des terroristes ou criminels de guerre.
Les sanctions prévues sont lourdes de conséquences : gel de tous les avoirs de la personne visée sous juridiction américaine, interdiction de séjour pour elle et sa famille, et surtout interdiction à toute entité américaine (ou personne soumise aux lois US) de lui fournir un soutien financier, matériel ou technologique. En clair, toute entreprise ou individu américain risquerait amende ou poursuites pénales s’il aidait directement ou indirectement Karim Khan ou la CPI dans ses activités.
Bien que les États-Unis ne soient pas membres de la CPI, cette offensive juridique vise à entraver les enquêtes internationales susceptibles de viser des ressortissants américains (par exemple pour les faits en Afghanistan) ou leurs partenaires stratégiques. Une mesure similaire avait déjà été prise en 2020 contre la précédente procureure, Fatou Bensouda, avant d’être levée en 2021 par l’administration Biden.
La récidive de 2025 marque donc un durcissement technopolitique majeur, suscitant une vague d’indignation mondiale.
Coupure des moyens numériques et dépendance technologique
Les effets des sanctions se sont immédiatement fait sentir sur les infrastructures numériques de la CPI et de son personnel. Dès l’annonce de l’ordre exécutif, Microsoft – le fournisseur de services de messagerie de la Cour – a supprimé le compte email professionnel de Karim Khan, le déconnectant brutalement de sa correspondance officielle.
Cette coupure a forcé le procureur à migrer en urgence sur ProtonMail, un service de messagerie chiffrée basé en Suisse, afin de rétablir des communications sécurisées hors de portée des juridictions américaines. La dépendance de la CPI à l’égard de fournisseurs technologiques américains est ainsi apparue au grand jour, car ce simple compte Microsoft était un outil critique du quotidien.
À la suite des sanctions, tout service numérique d’origine américaine – messagerie, hébergement cloud, outils collaboratifs – est potentiellement inaccessible pour le personnel sanctionné, sous peine pour les prestataires de s’exposer à de sévères pénalités.
En plus des communications, les ressources financières ont été visées. Les comptes bancaires de Karim Khan dans son pays d’origine, le Royaume-Uni, ont été bloqués par précaution, les banques craignant de violer les sanctions américaines. En effet, les banques internationales redoutent d’être exclues du système financier américain si elles traitent avec une personne placée sur liste noire.
Cette extraterritorialité de facto des sanctions américaines a un impact dissuasif massif : toute entreprise ayant des intérêts aux États-Unis, même basée en Europe, est incitée à rompre ses liens avec la CPI pour ne pas mettre en danger son accès au marché américain ou au dollar. Dans ce contexte, la migration vers ProtonMail – géré par une entité suisse indépendante – vise non seulement à protéger la confidentialité des échanges de la CPI, mais aussi à s’affranchir de prestataires soumis à la juridiction américaine et donc à la menace de coupure unilatérale.
Cette situation met en lumière la vulnérabilité technologique de la CPI, qui s’était naturellement appuyée jusqu’ici sur des solutions numériques globales dominées par des acteurs américains (Microsoft, Google, Apple, etc.).
Du jour au lendemain, une décision politique a pu priver un haut magistrat international de moyens de communication essentiels. Pour les professionnels de la cybersécurité, le cas de la CPI illustre les risques de concentration technologique et l’importance d’une stratégie d’indépendance numérique : diversification des fournisseurs, recours à des services chiffrés et hébergés hors de juridictions potentiellement hostiles, et plans de continuité d’activité pour pallier une éventuelle coupure brutale de service.

Coopération internationale entravée et climat d’autocensure
Au-delà de l’impact technique, les sanctions ont instillé un climat de peur et d’autocensure parmi les partenaires et personnels de la CPI. Le simple fait d’entrer en contact avec le procureur sanctionné ou de soutenir les activités de la Cour est désormais perçu comme un risque juridique.
Ainsi, plusieurs organisations non-gouvernementales ont cessé toute collaboration formelle avec la CPI depuis février 2025. Des associations de défense des droits humains basées aux États-Unis ont purement et simplement suspendu leurs projets communs avec la Cour. Dans l’une de ces ONG, les employés ont même été instruits de ne plus répondre aux emails en provenance de la CPI, de crainte d’attirer l’attention du Département d’État ou du Trésor américains.
Une autre organisation partenaire, qui joue un rôle crucial dans la collecte de preuves et l’identification de témoins, a transféré en urgence ses fonds hors des banques américaines, par peur de voir ses avoirs saisis ou gelés par les autorités des États-Unis.
Au sein de la Cour pénale internationale elle-même, l’effet est dévastateur. Les juristes et experts américains travaillant pour la CPI ont été avertis qu’ils risquaient une arrestation immédiate s’ils remettaient les pieds aux États-Unis, par exemple pour visiter leur famille.
Plusieurs hauts responsables ont préféré quitter leurs fonctions ces derniers mois, considérant la menace trop lourde pour poursuivre leur travail en toute sérénité. D’après des témoignages internes, l’équipe de Karim Khan a été réduite et certaines enquêtes sensibles sont au point mort faute d’appui logistique et de coopération internationale.
Le moral des troupes s’en est ressenti : « Est-ce que la Cour peut survivre à quatre ans de cette administration ? » s’interroge ouvertement un membre du staff, cité anonymement. La survie même de l’institution serait en question si ce régime de sanctions devait perdurer et s’étendre.
Ce gel des coopérations et l’isolement progressif de la CPI témoignent de l’efficacité redoutable des sanctions technologiques comme instruments de pression. La menace de poursuites ou de sanctions financières a un effet paralysant bien au-delà des cibles directes : c’est tout l’écosystème de la justice internationale qui entre en phase d’auto-censure. « Ces sanctions ne sont pas seulement une attaque contre la justice internationale – c’est une attaque contre l’état de droit et contre ceux qui ont consacré leur vie à le défendre », déclare ainsi Uzra Zeya, présidente de l’ONG Human Rights First.
Son organisation représente un juriste américain de la CPI poursuivant le gouvernement Trump en justice, car ce dernier se retrouve menacé de poursuites pénales simplement pour avoir continué à faire son travail sous l’autorité de Karim Khan.
Le message envoyé aux personnels et partenaires est clair et glaçant : toute personne qui collaborerait à l’avenir aux enquêtes de la CPI contre l’avis de Washington pourrait voir sa vie professionnelle détruite et sa liberté mise en danger.
Un tel climat de dissuasion globale perturbe gravement les échanges d’informations et le partage d’expertise pourtant indispensables pour traquer les auteurs de crimes internationaux.
Précédents techno-politiques et bataille de l’information
L’ingérence d’un État via des sanctions dans le fonctionnement d’une juridiction internationale indépendante soulève des questions inédites. Certes, les antécédents de frictions entre Washington et la CPI ne manquent pas : dès 2002, le American Service-Members’ Protection Act (surnommé ironiquement la « loi d’invasion de La Haye ») prévoyait déjà des mesures hostiles à la Cour.
Plus récemment, en 2020, l’administration Trump avait imposé des sanctions similaires à l’encontre de la procureure Fatou Bensouda et d’un de ses adjoints, en représailles à l’enquête CPI sur l’Afghanistan. Cette première salve avait suscité un tollé international, de nombreux gouvernements alliés dénonçant une attaque contre la justice globale, et deux recours juridiques avaient été lancés aux États-Unis pour contester la légalité de ces sanctions.
L’arrivée de Joe Biden à la Maison Blanche avait permis une désescalade rapide : en avril 2021, les sanctions contre Bensouda furent levées et un retour à la coopération avec la CPI s’était amorcé, notamment sur le dossier des crimes de guerre en Ukraine impliquant la Russie. L’épisode de 2020 apparaissait alors comme un accroc temporaire.
Mais le retour de Donald Trump au pouvoir a ravivé cette stratégie de confrontation frontale, poussée encore plus loin en 2025 par l’implication directe d’entreprises technologiques dans l’exécution des sanctions.
En effet, l’ordonnance de février 2025 innove en menaçant explicitement de poursuites quiconque « apporte un soutien financier, matériel ou technologique » aux efforts de la CPI.
C’est l’un des premiers cas où des acteurs privés du numérique – fournisseurs email, services cloud, etc. – sont contraints par la loi de participer à l’isolement d’un individu ciblé. On peut y voir une extension des mesures utilisées classiquement contre des organisations terroristes ou des États voyous, appliquées ici à une institution judiciaire internationale.
Ce mélange de technologie et de géopolitique n’est pas sans rappeler d’autres affaires récentes : par exemple, en 2010, la plateforme de paiement PayPal et plusieurs sociétés de cartes bancaires avaient bloqué les comptes de WikiLeaks sous pression politique, coupant les vivres du site lanceur d’alerte.
De même, en 2019-2020, des services en ligne comme GitHub ou Slack avaient dû restreindre l’accès de développeurs basés dans des pays sous embargo américain (Iran, Syrie, etc.) pour se conformer aux régulations de sanctions. Dans le cas présent, c’est une entité juridique internationale qui est prise pour cible, inaugurant un précédent technopolitique où la souveraineté numérique et la justice internationale s’entrechoquent.
Par ailleurs, d’autres puissances ont adopté des postures comparables pour se protéger des enquêtes de la CPI : en mai 2023, la Russie, furieuse de voir la CPI lancer un mandat d’arrêt contre Vladimir Poutine, a émis à son tour des mandats d’arrêt contre les juges et le procureur de la CPI, tout en criminalisant toute coopération de citoyens russes avec la Cour.
Israël, de son côté, envisage une loi punissant quiconque transmettrait des preuves à la CPI, afin de dissuader juridiquement la collaboration avec les enquêteurs internationaux. La manœuvre américaine de 2025 s’inscrit donc dans une tendance plus large de rejet de la juridiction de la CPI par certains États, s’appuyant sur des moyens technologiques (surveillance, sanctions financières, restrictions de services) pour imposer leur volonté politique.
Ces précédents sont lourdement chargés de conséquences : si de grands pays peuvent ainsi entraver les communications et les financements de la justice internationale, c’est l’efficacité même de la CPI qui est remise en cause à l’ère numérique.
Face à ce défi, l’Union européenne a commencé à évoquer des contre-mesures juridiques pour protéger ses ressortissants et entreprises des lois extraterritoriales américaines. Le blocage européen – un règlement visant à neutraliser sur le sol de l’UE les effets de certaines sanctions internationales jugées abusives – pourrait être mobilisé pour soutenir les activités de la CPI malgré l’offensive américaine.
Des États parties de la CPI discutent de solutions pour héberger hors des États-Unis les services critiques (comptes bancaires, infrastructures cloud) de la Cour afin d’assurer une résilience numérique.
Ces pistes s’inscrivent dans une bataille plus large pour la souveraineté technologique des organisations internationales et la préservation d’un espace sécurisé où la coopération judiciaire transnationale ne puisse être bâillonnée par des intérêts nationaux.
Réactions officielles et perspectives
L’onde de choc provoquée par les sanctions américaines a suscité de nombreuses réactions officielles à travers le monde. La Cour pénale internationale elle-même a immédiatement condamné ces mesures « sans précédent », dénonçant des attaques graves contre la justice internationale.
La présidente de la CPI, la juge Tomoko Akane, a déclaré dès février que ces sanctions constituaient « de sérieuses atteintes […] à l’ordre international fondé sur le droit et aux millions de victimes » que la Cour s’emploie à défendre.
Dans un communiqué, la CPI a réaffirmé son soutien indéfectible à son personnel, exprimant qu’elle « se tient fermement aux côtés » de son procureur et qu’elle poursuivra ses missions en toute indépendance malgré les obstacles. Karim Khan, bien que personnellement touché, a lui aussi fait savoir qu’il entend continuer son travail pour les victimes de crimes graves, refusant de se laisser intimider.
Du côté des gouvernements, la réaction a été largement solidaire de la CPI. Pas moins de 79 pays membres de la Cour – soit les deux tiers de ses États parties – ont cosigné une déclaration commune exprimant leur soutien « inébranlable » à l’institution et condamnant toute action visant à entraver son mandat.
De nombreux pays européens, africains, latino-américains et asiatiques ont rappelé l’importance d’une CPI indépendante pour lutter contre l’impunité. Les dirigeants de l’Union européenne, par la voix des présidents de la Commission et du Conseil, ont publiquement réaffirmé leur attachement à la Cour et critiqué les sanctions américaines qui menacent le fonctionnement de la justice internationale.
On note toutefois que quelques États traditionnellement alliés aux États-Unis se sont abstenus de soutenir la déclaration des 79 : le Japon, l’Australie ou encore la Hongrie (État membre de l’UE) ont gardé le silence, et ce dernier est même allé jusqu’à évoquer une possible réévaluation de son adhésion à la CPI.
Les organisations non-gouvernementales ont aussi fait front commun pour dénoncer la dérive américaine. Human Rights Watch a fermement critiqué l’ordre exécutif de Donald Trump, estimant qu’il « revient à placer les États-Unis du côté des criminels de guerre, au détriment des victimes » que la CPI cherche à protéger.
Human Rights First et l’American Civil Liberties Union (ACLU) ont quant à elles engagé des actions en justice aux États-Unis pour faire invalider les sanctions, au nom de la défense de la liberté d’expression et de l’indépendance judiciaire. Amnesty International a de son côté appelé les États parties de la CPI à prendre des mesures concrètes pour soutenir financièrement et logistiquement la Cour face à cette tentative d’intimidation, rappelant que l’objectif affiché de Washington est de la dissuader de remplir son mandat.
Des experts indépendants de l’ONU ont condamné une « attaque contre l’état de droit mondial » susceptible de saper la crédibilité des mécanismes de justice internationale.
L’administration Trump, pour sa part, campe sur ses positions. Soutenue politiquement par le gouvernement israélien – Benjamín Netanyahou a publiquement remercié Donald Trump pour son geste – et approuvée en coulisses par certains autres détracteurs de la CPI, la Maison-Blanche justifie les sanctions par la nécessité de protéger les citoyens américains (et alliés) de poursuites qu’elle juge illégitimes.
« Les actions de la CPI contre Israël et les États-Unis créent un dangereux précédent », affirme l’Ordre Exécutif, qui évoque une menace pour « les militaires américains en activité et les anciens combattants » impliqués dans des opérations à l’étranger.
L’équipe Trump considère la CPI comme une instance politisée et outrepassement de souveraineté, un discours en phase avec celui de 2020. En interne, le Département d’État et le Trésor se disent prêts à allonger la liste des personnes sanctionnées si la CPI persistait à enquêter sur des ressortissants protégés par les États-Unis.
Vers un bras de fer durable ?
Le bras de fer est donc engagé entre, d’une part, les partisans d’un ordre international fondé sur le droit, pour qui la CPI demeure un pilier incontournable de la lutte contre l’impunité, et d’autre part les tenants d’une vision souverainiste hostile à toute contrainte juridique supranationale.
Dans cette confrontation, les nouvelles technologies et les réseaux numériques se sont invités comme instruments de pouvoir et de coercition. Pour la communauté des professionnels de la cybersécurité, le cas de la CPI en 2025 sonne comme un avertissement : il révèle combien l’infrastructure digitale peut devenir le champ de bataille de conflits juridico-politiques.
Protection des communications, diversification des fournisseurs, cryptographie et souveraineté des données vont désormais de pair avec la défense des droits humains et du droit international.
La situation actuelle de la CPI reste précaire. Si les sanctions américaines ne sont pas suspendues, la Cour pourrait voir ses capacités lourdement diminuées, voire être paralysée dans certaines enquêtes faute de partenaires osant collaborer.
Néanmoins, le sursaut de soutien international et les recours judiciaires en cours offrent une lueur d’espoir pour contenir l’offensive. À plus long terme, cet épisode pourrait inciter la CPI et ses États soutiens à renforcer leur autonomie – tant financière que technologique – afin de poursuivre leur mission en évitant les points de vulnérabilité exploitables par des puissances hostiles.
L’équilibre entre la puissance des États et l’autorité du droit passera aussi par la capacité des institutions à se protéger dans le cyberespace. Ce « précédent Karim Khan » aura au moins eu le mérite de révéler cette nouvelle dimension du combat pour la justice internationale, où chaque email, chaque serveur et chaque ligne de code peuvent devenir des enjeux stratégiques.
En espérant que cet article vous apporte une vision différente de la géopolitique à travers le prisme de la cybersécurité.
Les sanctions imposées à la Cour pénale internationale révèlent combien les outils numériques — messagerie, hébergement, finance, interconnexion — sont devenus des leviers d’influence au cœur des rapports de force internationaux.
Dans ce nouvel équilibre, la maîtrise des dépendances technologiques et la résilience des institutions ne relèvent plus seulement de l’infrastructure : elles deviennent des enjeux stratégiques majeurs pour la souveraineté, la justice et la stabilité globale.
Enjoy !
Sources
- https://apnews.com/article/icc-trump-sanctions-karim-khan-court-a4b4c02751ab84c09718b1b95cbd5db3
- https://www.pbs.org/newshour/world/trumps-sanctions-on-iccs-chief-prosecutor-have-halted-tribunals-work-officials-and-lawyers-say
- https://www.reuters.com/world/us/war-crimes-prosecutor-first-target-trumps-icc-sanctions-sources-say-2025-02-07/
- https://www.hrw.org/news/2025/02/07/us-trump-authorizes-international-criminal-court-sanctions
- https://www.hrw.org/news/2025/02/12/world-responds-trumps-targeting-international-criminal-court
- https://humanrightsfirst.org/library/human-rights-first-sues-trump-administration-over-sanctions-threatening-u-s-prosecutor-at-international-criminal-court/
- https://www.amnestyusa.org/blog/what-do-the-trump-administrations-sanctions-on-the-icc-mean-for-justice-and-human-rights/
- https://next.ink/brief_article/microsoft-a-supprime-le-compte-email-du-procureur-de-la-cour-penale-internationale/



